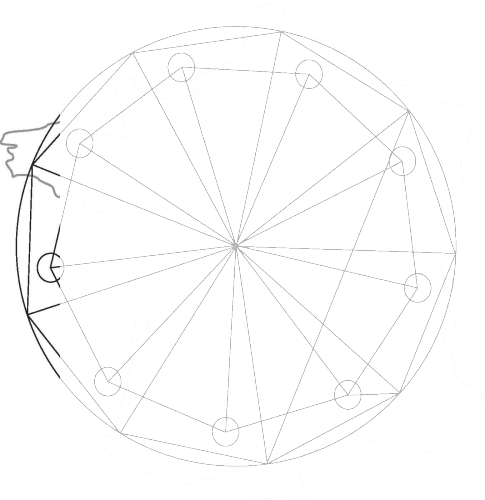Jacques de Vitry, qui vécut au XIIIème siècle, est le premier à rapporter par écrit la légende du mariage des neuf filles du Diable. « On a coutume de raconter que le Diable a engendré neuf filles d’une femme très laide, Concupiscence, laquelle par la brûlure de mauvais désirs est noire comme le charbon consumé, fétide par l’infamie, les yeux enflés d’orgueil, le nez long et tordu de ses machinations et de ses inventions pour le péché, les oreilles grandes, affreusement larges de curiosité, écoutant non seulement les rumeurs de la vanité, mais aussi les paroles d’iniquité et de médisance, les mains crochues de rapacité et de ténacité dans l’avarice, les lèvres béantes, et la bouche fétide d’un bavardage immonde ou inique, les pieds tordus, signe de dispositions mentales désordonnées, les seins volumineux, gonflés, prurigineux, galeux : de l’un elle abreuve ses petits du poison de la concupiscence charnelle, de l’autre, du vent de la vanité mondaine. Il a marié huit de ses filles à autant de catégorie d’hommes : Simonie aux prélats et aux clercs, Hypocrisie aux bourgeois, Dol [la fraude] aux marchands, Sacrilège aux paysans qui enlèvent aux ministres des églises les dîmes consacrées à Dieu, Feint-Travail [la simulation] aux ouvriers, Orgueil vêtement superflu aux femmes. Mais la neuvième, Luxure, il ne voulut la marier à personne ; mais comme une courtisane perverse elle se prostitue à toutes les catégories humaines, se mêlant à tous, n’épargnant aucun homme de quelque genre qu’il soit. Et les hommes baignant dans la puanteur de ses parfums se précipitent imprudemment à son bordel comme les oiseaux au lacet, les souris au fromage, les poissons à l’hameçon. Il est difficile pour un homme d’y réchapper une fois qu’elle a mis la main dessus. »
Parmi les filles du Diable, les sorcières, ou supposées telles, tiennent une place qui occupera les esprits pendant de longs siècles où la persécution sera remplacée par l’indifférence avant que de reconnaître que, pour celles qui pratiquaient effectivement, un véritable savoir était constitué.

Au nombre des accessoires entrant dans la panoplie des sorcières, on compte les poupées de cire et les « échelles de sorcières », sortes de chapelets fait d’une cordelette multicolore à 9 nœuds de plumes.
Le Malleus maleficarum (Marteau des sorcières) des théologiens Institoris et Sprenger, qui eut le dominicain Alain de la Roche, propagateur du culte du Rosaire, comme précepteur, paru en 1487 à Cologne, marque l’apogée de la littérature de combat contre la sorcellerie. Il définit une hérésie propre au sorciers et sorcières, qui, elles, sont particulièrement visées et constitueront la majorité des victimes de la chasse qui se déclenchera quelques décennies plus tard. Le Malleus, rédigé à partir du Directorium Inquisitorium de Nicolau Eimeric paru en 1376 et qui se veut un manuel pratique pour le jugement rapide des hérétiques, décrit les moyens utilisés par les sorcières pour nuire ainsi que la procédure pour y mettre fin. L’explosion de la persécution des sorciers et surtout des sorcières ou accusés comme tels, accompagne la longue remise en cause de l’Eglise catholique qui sera couronnée par la Réforme, elle-même hantée par le spectre de la sorcellerie, mais aussi une continue détérioration de l’image de la femme. En effet, les femmes avaient plus de droits au Moyen Âge qu’au XVIIème siècle. Le Malleus fait l’association entre la femme, le diabolique et le monstreux, qui se parachève dans le personnage de la sorcière, capable de transgresser tous les tabous, d’être une concurrente au masculin. La chasse ne sera pas cantonnée en effet aux régions catholiques, même si c’est un pays protestant, la Hollande, qui abandonnera le premier les poursuites, le dernier procès pour sorcellerie datant de 1610. Notons que c’est en Hollande que l’on inventa la pesée des sorcières. La ville d’Oudewater (Zuid Holland) est célèbre pour sa balance des sorcières (Heksenwaag) installée dans le bâtiment renaissance du Poids Public. Elle servait à déterminer si le poids des femmes accusées de sorcellerie était en rapport avec leur taille et qu’elles n’étaient pas trop lourdes pour chevaucher un balai. Toutes les personnes pesées, et cela jusqu’en 1729, furent acquittées. Le Sénat de la République de Venise décida en 1518, malgré la bulle Honestis du pape Léon X, que dans ce genre d’affaires les juges choisis à cet effet n’utiliseraient pas la torture, alors qu’à Côme 300 personnes montèrent sur le bûcher en 1514. Pour lui, les accusés avaient plus besoin de « prédicateurs que de persécuteurs ». L’Espagne se montra aussi plus clémente puisque l’épidémie qui régnait en France ne fit de ce côté des Pyrénées que 7 victimes. De l’autre côté, en France, Lancre se rendra tristement célèbre dans le Labourd où il fera des centaines de victimes. Le Labourd est une région tardivement rattachée au royaume, et, comme dans d’autres régions rétives, les persécutions des sorcières sont un instrument pour imposer l’obéissance aux nouveaux sujets. Ailleurs en Europe, de prétendues sorcières ou sorciers seront brûlées, 900 à Würzburg de 1623 à 1631, 600 à Bamberg en dix ans, plus de 300 à Quedlinburg en Saxe en 1589, 368 sorcières dans l’Electorat de Trèves sous l’égide de Johann de Schöneburg et de l’évêque Binsfled. En Angleterre, Matthew Hopkins aurait fait périr 200 personnes de 1644 à 1646.
Si c’est la justice laïque qui se chargea de mener à bien ses procès, l’Eglise, avec ses théologiens comme Sprenger, édifia tout l’arsenal juridique pour inventer et codifier le crime de sorcellerie. Le Marteau des sorcières, édité en format de poche facile à consulter, « fut aux procès de sorcellerie ce que le Code civil est à notre basoche [1]». Ce sont les juges, courroie de transmission des classes aisées, qui manient l’épouvantail du diable et transforment en satanisme une sorcellerie populaire à laquelle on fait appel pour expliquer les malheurs accumulés qui s’abattent sur les hommes au cours de leur vie.
La sorcière type semble être une paysanne, « vieille femme décrépite », expression tirée des lettres de Philippe II d’Espagne, et d’un niveau de vie inférieur à celui de leurs accusateurs. Elle est aussi généralement veuve, isolée, échappant au contrôle patriarcal. La sexualité lui donc est refusée et forcément déviante et diabolique si l’interdit est enfreint. Comme femme âgée, elle était la dépositaire d’une culture orale entachée de paganisme pour les tenants de la Contre-Réforme comme de la Réforme qui imposaient de nouvelles normes de comportement plus rigoureuses par une surveillance accrue des populations. Mais « la sorcière n’était ni une révoltée, ni une exclue, ni une déviante [2]». Le supplice des sorcières avait un sens social : « un bouc émissaire choisi au sein de la communauté brûlait. Les spectateurs pouvaient avoir l’illusion d’avoir écarté d’eux tous les dangers, tous les problèmes. L’unanimité retrouvée pour un instant abolissait toute tension au cœur du village, ainsi qu’entre ce dernier et la société dominante [3]». Celle-ci transmettait aux paysans aisés, bénéficiant d’une récente alphabétisation dont étaient exclues les femmes, sa peur de perdre ses privilèges par une rébellion des couches inférieures de la société. Si la première moitié du XVIème siècle est marquée par des échanges entre culture populaire et culture savante, ce qu’illustre un Rabelais, la deuxième moitié voit une reprise en main des populations par les classes dominantes avec l’acculturation de la paysannerie aisée et de la petite bourgeoisie, le contrôle des groupes marginaux et l’intensification des procès en sorcellerie.
Ainsi la région de Luxeuil est sujette à une révolte de paysans en 1628 qui déclenche une chasse aux sorcières au cours de laquelle les accusés décrivent des sabbats insensés. Les environs de Quingey, lieu de naissance du pape Calixte II, présentent le même contexte qu’à Luxeuil et se sont hérissés de gibet et de fourches patibulaires qui cohabitent avec des lieux de sabbats : le Bief de la Barge, le Prieuré de Lieu-Dieu. Quingey est un centre de répression de la sorcellerie en Franche-Comté. Marguerite Touret, dite la Bernade, exerçait la « médecine » à Besançon. Un jour elle conseilla à la femme d’un malade de la fièvre d’envoyer celui-ci maudire trois fois une certaine herbe pendant 9 jours pour le guérir. Des paroles imprudentes, suivies de morts suspectes de bétails, puis une dénonciation de participation à des sabbats l’envoya devant les juges qui firent une recherche de marques sur son corps que trois-maîtres chirurgiens trouvent. Un « piqueur » lui enfonce même une aiguille dans la région des seins à l’emplacement d’une des marques sans qu’elle n’en souffre, signe évident de sorcellerie. Marguerite finira brûlée le 10 juin 1658 comme il se doit, à Quingey qui verra comparaître en 1659 Marie Virot, filleule d’une marraine elle-même sorcière.
Marie Cornu, dite la Rousse, avouera avoir commis les pires débauches avec le Diable. Mais ses aveux les plus significatifs sont ceux d’avoir fait périr des veaux de plus fortunés qu’elle et qui lui avait refusé des services. Cela manifeste « une conscience d’opposition, à défaut d’une improbable conscience de classe des plus pauvres [4]» dont l’impuissance face aux nantis créait les rêves de vengeance magique à leur encontre. Elle fut étranglée et brûlée à Fenain le 14 février 1611.
Tous ceux accusés de sorcellerie ne sont pas exécutés. Marguerite Carlier d’Oisy-le-Verger en Artois, est dénoncée en 1612 par des sorciers mis à mort peu après. Par son caractère indomptable et ses recours en justice, malgré la torture sous laquelle elle n’avoue rien, elle échappe au bûcher, mais pas au bannissement. Elle rompt son ban en retournant dans sa famille et est condamnée à 9 années supplémentaires d’exil en 1614. Finalement elle se fera pardonnée en 1619.
Un corollaire de la sorcellerie est la possession qui fait avouer à ses victimes des sévices sexuels et leur fait accuser des innocents. Ainsi Madeleine Bavent, nonne au couvent des hospitalières de Saint-Louis et Sainte-Elisabeth à Louviers, accusa un prêtre mort récemment, le curé Picard, et son vicaire Thomas Boullé de l’avoir engrossée plusieurs fois et d’avoir crucifié ses enfants pour en tirer des charmes de leurs cendres. Pour une fois, ce sont des hommes qui étaient accusés de sorcellerie et des prêtres en plus ! Boullé et le cadavre de Picard furent condamnés à être brûlés par le Parlement de Rouen. Cette affaire se déroulait dans la même année 1634 où fut exécuté Urbain Grandier, victime des ursulines possédées de Loudun.
Dans ce climat, l’accusation de sorcellerie pouvait être induite par des questions d’héritage. Catherine de Draguignan recueillit l’entièreté de l’héritage de son père, spoliant ainsi ses sœurs et ses beaux-frères dont un l’accusa d’avoir usé de potion pour circonvenir Guilhem David, le père. Catherine prêtait le flan à une telle attaque car elle fréquentait assidûment Monnet Sinhon, de Figanières, réputé sorcier, alchimiste et suspecté de fréquenter la synagogue. Celui-ci avouera avoir fourni une potion à Catherine, mais se rétractera en disant que ses accusations étaient proférées sous l’influence d’un Chat noir du nom de Barabbas. Etrangement, Catherine et Monnet bénéficieront de la clémence de l’inquisiteur Guilhem de Malavielle qui condamnera le sorcier à demander pardon à Dieu chaque jour et absoudra Catherine.
Des voix s'élèveront pour défendre les accusés comme celle de Jean Wier (Grave-sur-Meuse, 1515 - Tecklenburg 1588) qui, sans nier la réalité des maléfices du diable, considérait que les sorcières étaient des malades mentales et devaient être soignées par des médecins. Wier suivait en cela son maître Heinrich Cornelius Agrippa (Cologne, 1486 - Grenoble, 1535) qui défendit une "sorcière" de Woippy alors qu'il avait été nommé orator et advocatus de la ville de Metz, par l'entremise de la famille Laurencin de Lyon, dont un membre, Ponce, était gouverneur de l'Ordre de Saint-Jean de Metz. Pour la défense de la pauvre femme, Agrippa rédigea deux playdoyers où il relève l'irrégularité et l'illégalité de la procédure, un problème de juridiction, et l'hérésie des accusateurs qui niaient l'efficacité du baptême de l'accusée, même si sa mère avait déjà été brûlée comme sorcière.

Les sorcières trouvèrent du répit au XVIIIème siècle et furent alors accaparées par la littérature. Le Diable boiteux de Lesage, Le Diable amoureux de Cazotte, Faust de Goethe et surtout le Manuscrit trouvé à Saragosse de Potocki (Pikow, Podolie, 1761 – Uladowka, 1815) qui fut un archéologue et historien, créateur de l’ethnologie slave. Ecrit en Français (1801 – 1805), le Manuscrit fait la part belle aux fantômes, vampires distingués entre ceux de Pologne et de Hongrie qui sont des corps morts suceurs de sang et ceux d’Espagne, qui sont des esprits prenant possession des corps et les transformant à leur guise, démons et cabalistes. On y rencontre Alphonse van Worden qui réchappera à l’Inquisition ; dom Bélial, démon tentateur, qui prône l’amour de soi. Faisant dire à van Worden qu’il n’existait plus alors de possédés contrairement aux premiers siècles de l’Eglise, Potocki témoignait de l’évolution des idées et de la transformation de la religion en une religion naturelle, fondée sur la raison, encore opposée au matérialisme d’un don Bélial. Au XIXème siècle, Nodier produira Smarra ou les démons de la nuit, Hoffmann Le chien Berganza, Balzac Melmoth réconcilié.
En plein XXème siècle, l’affaire du curé d’Uruffe est à rapprocher de pratiques de sorcellerie. Guy Desnoyers, ordonné prêtre en 1946, était curé de la paroisse d’Uruffe. Il fut jugé et condamné pour le meurtre, en 1956, de sa maîtresse de 19 ans, enceinte, d’une balle dans la nuque. Il l’éventra pour en retirer l’enfant qu’elle portait, presque à terme, le taillader et l’achever à coups de couteau, après l’avoir baptisé d’une croix sur le front.
[1] Colette Piat, « Quand on brûlait les sorcières », Presse de la Cité, p. 9
[2] Robert Muchembled, « La sorcière au village – Xvème – XVIIIème siècle », Folio-Gallimard, p. 291
[3] Ibid., p. 268
[4] Ibid., p. 218