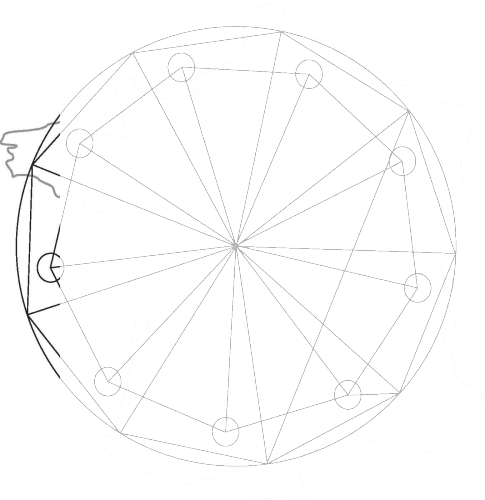Les procès qui jalonnent l’histoire, en liaison avec les nonagones, ceux de Jeanne d’Arc à Rouen, de Gilles de Rais à Nantes, de Jacques Cœur, du duc de Nemours, de Landru à Versailles, de Léon Blum à Riom montrent l’instrumentisation de la justice par le pouvoir politique et religieux. La justice est en effet une des principales attributions de ceux qui sur la terre étaient les représentants les plus qualifiés de Dieu, puis qui exercent l’autorité au nom du peuple. L’histoire d’Israël montre que les qualités et les fonctions des juges, qui précèdent l’apparition des rois, ont servi de modèle à la royauté. Les romans médiévaux, Perceval en particulier, montrent bien que l’arbitre, en dernier ressort, est le roi. C’est pourquoi, lorsque Perceval vainc un ennemi, Clamadeu, Aguingueron etc., il l’envoie auprès d’Arthur qui doit décider de son sort.
La justice des hommes semble n’être que l’application d’un ordre sanctionnant la loi du plus fort ainsi que le pensait Blaise Pascal dans une perspective pessimiste. « On ne pourra jamais faire pénétrer la justice authentique dans les institutions : les hommes en effet se trouvent rarement d’accord sur ce qui est idéalement juste. En revanche, la force, fait empirique, se reconnaît sans équivoque possible : les triomphes ou les victoires militaires en témoignent. C’est ainsi que, n’ayant pu donner la force à la justice, « on a fait que ce qui est fort fût juste », on n’a pas pu faire autrement que de donner le sceau de la légitimité ou de la justice à la force. »[1]. Pour Pascal, « la force est la reine du monde ».
Même la Révolution française qui reconnaît aux citoyens les droits qui protègent sa liberté est le fruit d’une montée en puissance d’une classe sociale, la bourgeoisie, qui décide de prendre en main son destin, et celui des autres classes.
Aussi imparfaite qu’elle soit, la justice humaine permet cependant la réparation, dans une certaine mesure, des torts provoqués par l’infraction aux lois qui met en cause le vivre ensemble de la société. « L’audience, par la parole, répète, commémore un événement pour l’épuiser dans une catharsis. On ne répare évidemment rien avec la peine : on ne ressuscite pas les morts mais la rectitude est rétablie dans l’ordre symbolique par le prononcé déclaratoire de la peine infligée parce que méritée. Les avocats et les juges témoignent tous de la même expérience : il y a dans le prononcé de la peine une libération pour celui qui est condamné et pour la partie civile, lorsqu’il s’agit d’un crime de sang, la possibilité enfin d’entrer dans le travail de deuil »[2].
Cette entrée dans l’intime des personnes par l’intermédiaire d’un rituel tout extérieur où s’impose la force de la loi nous amène à aborder une idée de la justice plus personnelle.
La civilisation européenne est sans doute la seule à reposer sur la référence à deux justes suppliciés, mis à mort injustement, Socrate et Jésus, et témoignant tous deux de la transcendance absolue de l’esprit jusqu’au cœur de l’épreuve suprême.
Pour Socrate il existe une Idée de la Justice, transcendante à l’expérience humaine, qui ordonne le cosmos. « Il s’agit de naître à une vérité intérieure, laquelle ne peut être prouvée par des arguments extérieurs et n’apparaît qu’à une âme amoureuse de sa quête. Dans cette optique, la justice ne peut être que révélation, intérieure à l’âme, que son bien réside dans son accord avec l’ordre transcendant du cosmos. »[3]. Socrate, premier juste, premier témoin de ce qui, au cœur de l’homme, transcende absolument sa dimension empirique, « éprouva le plus grand respect pour les âmes qu’il approchait, avec le sentiment profond qu’elles étaient toutes singulières et que son rôle à lui était de les aider à trouver leur harmonie propre, harmonie intérieure qui se traduit en justice dans l’ordre moral, en vérité dans l’ordre de la pensée, en bonheur dans l’ordre de l’action. L’âme ne peut se voir que dans un miroir plus pur que ce qu’il y a de meilleur en nous : ce miroir ne peut être qu’un dieu intérieur à l’âme […] Quand un homme est parvenu à donner à son âme conscience de son intériorité, il possède le bonheur. »[4].
Le christianisme a introduit de même un principe de singularisation. « Là où la Loi règle l’échange, Jésus de Nazareth pratique une singularisation qui déforme la Loi pour l’ajuster à la rencontre de chacun. Au-delà de l’obligation à la réciprocité rigoureuse, du donnant-donnant de l’échange et de l’éducation au sentiment que je ne suis pas seul mais avec les autres, il y a une sollicitude et un souci extrême des singularités, venant panser les manques du jeu social dans l’automaticité de ses mécanismes, l’impossibilité pour une société d’être entièrement juste avec chacun, d’accepter son entière singularité avec celle de tous les autres, de refuser qu’un système laisse aux frontières de l’échange des victimes pour lesquelles on ne puisse rien, bref de faire que tout soit objet de rétribution »[5]. Le chrétien est délivré des contraintes imposées par la Loi pour vivre par la foi, conformément à la sentence d’Habacuc : « Le juste vivra par sa foi » ».
Avec saint Paul la justice est force de la vie nouvelle, conduisant à la grâce. « Justice et vie sont unies. Le mouvement de la vie alimentée par la source ontologique qu’est Dieu qui donne, déclenché par le don de justice – pardon justifiant – a pour but et conséquence la participation à la vie de l’éternité. »[6]. Assuré de la résurrection, le juste, qui ne se connaît pas forcément comme tel, accomplit la parole divine, selon saint Augustin, par sa volonté libre du péché dans laquelle la liberté du vouloir est étroitement unie à son efficace, à son pouvoir. La grâce – événement interne au psychisme qui permet la réunification du moi divisé pour que la volonté se libère de sa servitude qui l’empêche de pouvoir.
Cette attention à l’autre, chrétienne ou socratique, fait place à l’épanouissement personnel loin de l’idéologie uniformisante, mais dans le respect de l’autre qui garantit le bien vivre ensemble. Dans la croyance en Dieu, cela privilégie un rapport direct à la divinité dans une expérience mystique vécue par les prophètes d’Israël que la Bible rapproche des fous qui tous deux ont un rapport immédiat au fond des choses, irréductible à la raison humaine. Contrairement à ce qui s’est passé partout ailleurs dans le monde antique, la justice est restée, en Israël, éminemment religieuse. Si Hammourabi reçoit son code du dieu Shamash, l’esprit du code est entièrement laïc et ne doit rien à la divinité. Pour les prophètes, la justice est l’attribut principal de Dieu : ils ne l’attendaient que de Dieu, dont la nature insondable ne pouvait être assimilable à quelque chose de froidement rationnel. Les prédications du prophète (nabi) recherchent la conversion des cœurs, qui ouvre au salut, c’est à dire à la justification dans un dialogue toujours renouvelé avec le Dieu vivant. La dénonciation systématique de l’infidélité d’Israël à l’esprit de sainteté et de fraternité, le jugement prononcé sur une société qui lui fait prendre conscience de sa faillibilité, lui permettent d’avancer sur la voie de la rédemption.
Ce rapport intime avec Dieu nourrit la pensée protestante. Pour Luther qui apprit des mystiques rhénans que la foi, loin de se réduire à un énoncé dogmatique est d’abord une expérience spirituelle authentique, c’est dans la foi véritable, c’est-à -dire dans l’abandon à Dieu lui-même, par une mort au monde et à soi-même, que peut s’opérer la transformation profonde du moi, sa naissance à l’être véritable, le devenir juste c’est-à -dire la justification. La pensée de Luther est, comme celle de saint Paul et d’Augustin, une pensée de la guérison de l’âme affectée aussi longtemps qu’elle croit pouvoir naître à elle-même selon les lois de la chair, incapable de trouver le chemin de la paix et de la joie.
« Souffrir Dieu pour ensuite agir avec lui, tuer le Ich, le moi et le vieil homme pour affirmer le devenir dans le « Entwerden » ou dédevenir, le non dans le oui, la lumière dans les ténèbres. »[7]. Luther « pose au centre de sa pensée la contradiction comme révélation de la plus profonde vérité sur Dieu ». (Les racines hébraïques du monde moderne, S. Quinzio). Commentant l’Epître aux Romains, Luther écrit : « Notre bien est caché et si bien caché qu’il est caché sous son contraire. Ainsi, notre vie est cachée sous la mort, l’amour de Dieu sous la haine contre nous, la souveraineté sous l’ignominie, le salut sous la corruption, la majesté sous la misère, le ciel sous l’enfer, la sagesse sous la folie, la justice sous le péché, la force sous la faiblesse. »
La mort du vieil homme, l’unification de soi, la montée vers l’Un, l’expression paradoxale de Luther entrent en concordance avec l’alchimie qui connut un renouveau avec les Rose-Croix, nés en Allemagne protestante, et professant l’alchimie philosophique.
L’amour et la justice sont intimement liés. Dans le Lévitique on peut lire : « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahvé ». Le juste respecte la volonté de Dieu qui éclaire les hommes afin de les rendre vivants et heureux. Est juste celui qui pratique la justice en fonction de l’amour de Dieu qui seul fait vivre dans la plénitude. De même aimer c’est savoir faire des remontrances, exprimer le ressenti d’une attitude offensante, pour éviter d’endosser la faute du prochain sous la forme de la rancune, ou de la vengeance. « Rendre à chacun son dû est vrai aussi lorsqu’il s’agit de l’échange, du commerce des hommes où ce ne sont pas des marchandises qui circulent mais les affects. »[8].
La justice se fonde sur l’amour, la charité. Pour Lévinas, la justice naît de la charité car c’est Dieu qui nous justifie. La croyance en Dieu qui institue la justice de Dieu, provient de l’expérience de la rencontre d’autrui. Lévinas appelle visage la manière dont se présente l’Autre à soi-même qui dépasse l’idée de l’Autre que l’on s’en fait. L’Autre exerce une contre-intentionalité qui nous échappe et sur laquelle on n’a pas de prise. Finalement, c’est en abordant autrui que l’on assiste à soi-même. « La subjectivité vivante est ouverture à l’autre. Elle ne consiste pas à reposer en soi, mais au contraire, à se dé-prendre de soi et à craindre pour l’autre…Autrui fracture la clôture du moi »[9]. Ainsi naît l’exigence éthique lorsque la liberté se sent arbitraire. Pour Lévinas, le visage d’autrui induit l’interdit « Tu ne tueras pas » qui impose au meurtrier de savoir ce qu’il a fait sous le regard de l’autre, dans l’espace de transcendance qui ouvre sur l’infini et aboutit à l’idée de justice. Nous retrouvons ici Ramon Llull dont l’œuvre est dominé par le thème de l’altérité et de l’altération : « altérité du Tout Autre bien sûr, mais aussi altérité de l’infidèle et du chrétien, et altération de soi par la conversion et par la folie. Dans la mise en chantier de la pensée, l’importance du dialogue ou de la citation des paroles est tout à fait remarquable. Raymond, lorsqu’il écrit, cite ses paroles et celles de ses adversaires directs, chrétiens ou infidèles, ce qui implique une déstabilisation incessante. Ce dialogue est le premier espace qui « désigne l’écart et la séparation comme l’origine de toute valeur positive » (Maurice Blanchot) […] Le sens est dans le jeu réciproque des perspectives, au croisement. Le dialogue est alors véritable et l’autre du dialogue n’est pas un effet de style. La parole de Raymond Lulle n’est pas une parole unifiante ; elles cherche la séparation, l’intervalle dans lequel l’Autre a la possibilité d’être [10]». Traducteur de Ghâzâli,, il s’en inspira. Ghâzâli écrit dans Le Critère de l’action, composé au début de sa retraite en 1095, que « dans la fréquentation des autres, l’homme acquiert ses premières connaissances et les parachève » et que « le but de toute politique est de se préparer et de préparer les autres au bonheur final qui est celui de la connaissance de Dieu ». Il faut donc « lutter contre toute forme de fanatisme et d’intransigeance partisane, contre tout attachement aveugle à une école ou à une secte, afin de reconstituer l’unité de la communauté [11]».
Le refus de l’autre s’exprime en particulier par la chosification des individus. Le meurtre en série ravale les victimes au niveau de simples produits fabriqués eux-mêmes en série dans l’industrie moderne. Au cours de son procès à Versailles, du 7 au 30 du très froid mois de novembre 1921, Landru déclarait : « J’ai changé de villa par raison d’économies. A Gambais, c’était moins cher et aussi mieux disposé pour les usages industriels ». Landru nia sa culpabilité jusqu’à sa mort. C’était semer le doute sur la mort des femmes qu’il avait séduites et continuer à s’imposer dans l’esprit des familles des victimes et du public comme il avait contrôlé la vie et la mort de ses victimes.
[1] France Farrago, « La justice », Armand Colin, p. 118
[2] ibid., p.217
[3] ibid., p. 43
[4] ibid., p. 33
[5] ibid., p. 83
[6] ibid., p. 86
[7] ibid., p. 102
[8] ibid., p. 86
[9] ibid., p. 192
[10] Dominique de Courcelles, « La parole risquée de Raymond Lulle », Vrin, pp. 11-12
[11] Ibid., p.158